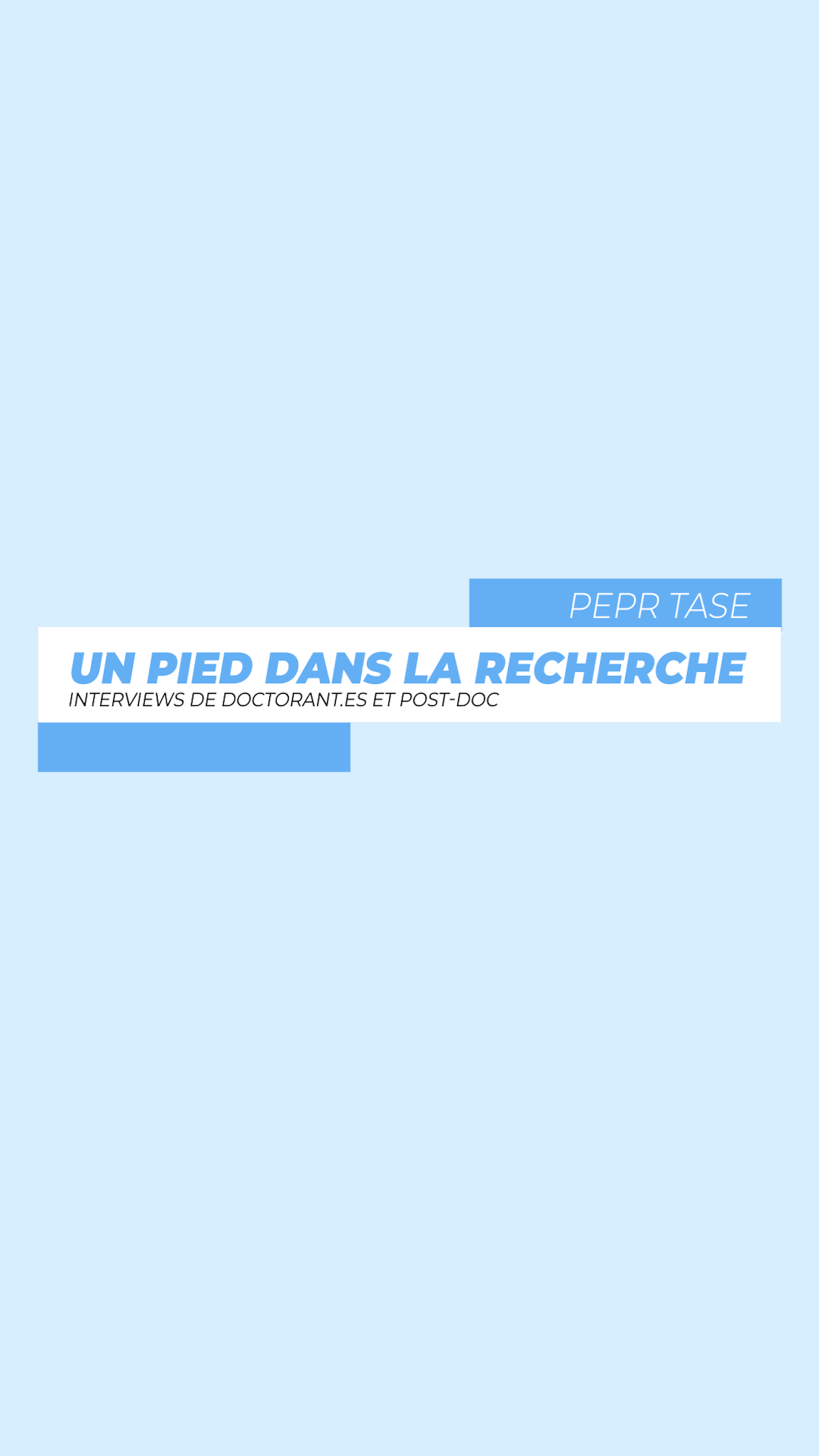Cellules tandem
et matériaux biosourcés
Pour minimiser l’impact environnemental des technologies PV, les efforts devront essentiellement porter sur la réduction du poids des modules, leur démantèlement ainsi que leur éco-conception. Dans cet objectif, le développement de technologies intégrant des matériaux biosourcés est une voie particulièrement prometteuse qui, en plus de l’éco-conception, facilitera les procédés de recyclage. En parallèle, les recherches visant à augmenter l’efficacité des cellules solaires continuent. L’objectif est de préparer la prochaine génération à haut-rendement, avec comme piste privilégiée la conception de cellules tandem, combinant différents types de matériaux.
Des matériaux de protection biosourcés…
Par Sylvain Chambon et Marie Gueunier-Farret (IMS Bordeaux), pilote et membre du projet BioFlexPV
Les modules en silicium cristallin (c-Si) représentent 98% du marché photovoltaïque. Cette technologie, mature sur le plan industriel, présente des records d’efficacité de 27,3% en cellule laboratoire et jusqu’à 25,4% en module (données du NREL). Très robustes, ces modules présentent une excellente durée de vie au-delà de 25 ans. Cependant, leur fin de vie est un enjeu majeur : comment recycler et valoriser au mieux leurs matériaux d’intérêt (verre, argent, silicium, acier…) ?
Les solutions d’encapsulation actuelles constituent une des plus grandes difficultés dans la récupération des matériaux et le recyclage des panneaux c-Si. En effet, la combinaison de l’EVA (copolymères d’éthylène et d’acétate de vinyle) et du verre, solution d’encapsulation efficace et la plus couramment utilisée, ne permet pas une séparation bien contrôlée des couches pour permettre la valorisation des différents éléments. Par ailleurs, le poids et le budget thermique du verre incitent à trouver des solutions d’encapsulation plus légères et moins coûteuses en énergie.
De nouvelles générations de modules PV ont émergé au fil des années : les technologies couches minces dont fait partie le CIGS (un alliage de cuivre, indium, gallium et sélénium) et, plus récemment, les technologies dites « perovskites » (à base de matériaux perovskites) et « organiques » (à base de semiconducteurs organiques). En quelques années, ces deux dernières technologies ont montré une progression impressionnante de leurs performances PV avec des records respectifs certifiés de 26,7% et 19,2%.
Elles présentent plusieurs avantages dont la réduction du coût énergétique de fabrication des modules :
D’une part l’absorbeur est une couche mince d’épaisseur inférieure au micron composée de matériaux abondants ; D’autre part, les procédés de fabrication sont des procédés basse température nettement moins complexes à mettre en œuvre que dans l’industrie silicium.

© Cyril FRESILLON – IPVF – CNRS Images
Pour les modules flexibles organiques et perovskites, la solution d’encapsulation couramment utilisée consiste à laminer un film barrière sur le module et à le sceller via différents types de résines encapsulantes. Le film barrière ainsi que le matériau de scellage sont tous deux issus de ressources non-renouvelables et représentent environ 2/3 du poids des modules. Ils sont en effet constitués de matières plastiques à l’origine de problématiques de pollution environnementale. Ainsi, pour le développement de ces nouvelles générations de panneaux PV, la réduction de leur impact sur l’environnement passe par le remplacement de ces films barrières petrosourcés par des solutions renouvelables.
Le projet BioFlexPV vise à amorcer cette transition de la filière photovoltaïque en améliorant la recyclabilité des panneaux et en développant des solutions d’encapsulation pérennes avec une empreinte environnementale réduite. L’objectif principal du projet est donc de développer de nouveaux matériaux d’encapsulation efficaces à partir de matières biosourcées ou abondantes pour minimiser la dépendance des filières PV à des ressources non renouvelables. Le projet rassemble 8 laboratoires répartis sur 5 sites en France. Il regroupe diverses compétences allant de la synthèse des matériaux, qui formeront les briques de base pour la construction des films barrières, à l’intégration de ces films barrières dans diverses technologies PV (c-Si, organique, perovskite et CIGS). Les films d’encapsulation fabriqués dans le cadre du projet combineront des polymères issus de la biomasse, des couches denses inorganiques issues de ressources abondantes et devront présenter des propriétés barrières aux gaz élevées. Le projet intègre également des analyses de cycle de vie des matériaux et des dispositifs, ainsi qu’une étude de démontabilité des panneaux.
En combinant ces différentes approches, le projet BioFlexPV ambitionne de développer des stratégies d’encapsulation à faible impact environnemental qui pourront être appliquées aux futures générations de modules PV.
… aux cellules tandem à haut rendement
Par Stéphane Collin (IPVF), pilote du projet IOTA
L’efficacité des cellules solaires en silicium continue de progresser régulièrement et se rapproche du maximum théorique de 29,4 %. L’enjeu aujourd’hui est de préparer la prochaine génération de cellules solaires dont l’efficacité dépasserait les 30 %. L’approche privilégiée par la communauté scientifique repose sur une architecture tandem formée de deux cellules solaires juxtaposées. La cellule inférieure peut être en silicium, utilisée alors pour convertir uniquement la partie infrarouge du spectre solaire. La cellule supérieure doit être constituée d’un semiconducteur à grande bande interdite, plus efficace pour convertir la partie visible de la lumière solaire, et transparente dans l’infrarouge. Il existe plusieurs matériaux, déposés en couches minces, qui peuvent jouer ce rôle.
Les combinaisons formées de perovskites hybrides sur silicium sont les plus étudiées actuellement : elles ont fait des progrès très impressionnants au cours de 15 dernières années, avec des efficacités qui ont maintenant dépassé 34 %. Néanmoins, elles ne parviennent pas encore à concilier faible coût, haut rendement et grande durée de vie. D’autres technologies de films minces, comme le CIGS (un alliage de cuivre, indium, gallium et sélénium), constituent des alternatives qui ont démonté de très bonnes stabilités et un potentiel industriel, mais avec des efficacités encore faibles lorsqu’elles sont utilisées comme cellule supérieure d’une tandem. Associer perovskites et CIGS est également possible, avec un record récent supérieur à 30 %. Il n’existe donc pas encore de technologie conciliant bas coût, haut rendement, grande durée de vie et un potentiel d’industrialisation à grande échelle. Le point commun des différentes architectures, c’est un empilement complexe de matériaux, et une multiplication des interfaces qui complique le contrôle et l’absorption de la lumière, et la collection du courant.
L’objectif du projet IOTA, qui rassemble 16 laboratoires français, est de développer des solutions innovantes pour faciliter l’émergence et l’industrialisation des cellules tandems. Il s’attaque à plusieurs verrous, qui portent notamment sur le contrôle de la texturation des surfaces, le dépôt de couches adaptées à cette texturation, la recherche de nouveaux matériaux pour former les couches d’interface qui faciliteront le dépôt ou le collage des cellules, et le transport du courant. En s’appuyant sur les expertises variées présentes au sein de ce large consortium, le projet IOTA vise à la foi à développer des briques technologiques transversales adaptées à différentes combinaisons de matériaux (perovskites, silicium, CIGS…), mais aussi à intégrer ces solutions dans des cellules solaires tandem à l’état de l’art pour accélérer leur industrialisation future.
Trois questions à : HELIUP, fabricant de panneaux PV
Réponses de Julien GAUME, CTO et co-fondateur d’HELIUP
Quelles sont selon vous les recherches prioritaires à mener dans les prochaines années en termes de photovoltaïque ?
Les recherches sont multiples, mais pour donner quelques exemples, on peut notamment citer la réduction des matériaux critiques (argent, indium, plomb) dans la composition de la cellule. Une autre innovation intéressante serait de passer le cap des 30 % de rendement module avec des architectures tandem Si/perovskite, Si/CIGS ou tout autre rupture technologique à venir. Il est également essentiel de travailler à alléger et décarboner le module, à l’aide de substrats minces ou composites.
Avec HELIUP, nous avons réussi à atteindre moins de 5 kg/m², pour rendre le PV accessible aux toitures industrielles à faibles charges. Il faut cependant penser à l’aspect fiabilité et durée de vie, car s’il est relativement simple d’alléger un panneau, la difficulté réside dans la conservation de ses performances sur des durées de vie supérieure à 25-30 ans. Un autre sujet d’importance est l’encapsulation circulaire, tels que les films barrière biosourcés, les adhésifs réversibles ou une démontabilité sélective pour faciliter un recyclage et atteindre 100% de réutilisation. Enfin, avec le développement d’une surveillance et d’une fiabilité accélérées, à travers les jumeaux numériques et l’IA, il sera possible de démontrer en quelques mois des durées de vie supérieures à 30 ans.

© Heliup
Quelles sont vos attentes sur les travaux de recherches de IOTA et BioFlex-PV en termes de développement des cellules photovoltaïques et de leur encapsulation ?
Dans le cadre des travaux de IOTA, nous souhaiterions intégrer des cellules tandems sur notre panneau Stykon® sans surpoids et viser 25-27% de rendement module en 2028. Les travaux de BioFlexPV, pourraient quant à eux nous permettre de diviser par deux l’empreinte carbone du module et de garantir une recyclabilité proche de 100 %, tout en conservant une garantie produit de 25 ans.
Comment les recherches du PEPR pourraient s’intégrer dans vos activités ?
Nous pourrions travailler au co-développement d’un démonstrateur tandem Stykon léger pour application toiture et réflechir à la production en série de ces panneaux avec encapsulation biosourcée, ainsi qu’un protocole de démontabilité adapté à leurs spécificités. Grâce à ces synergies, Heliup pourrait viser un rendement module supérieur à 25 % dès 2028. Ajouté à cela les améliorations en termes d’empreinte carbone et de recyclabilité, tout en conservant une signature produit « léger et rapide à poser » déjà validée sur le marché industriel.
Plus d'actualités Article